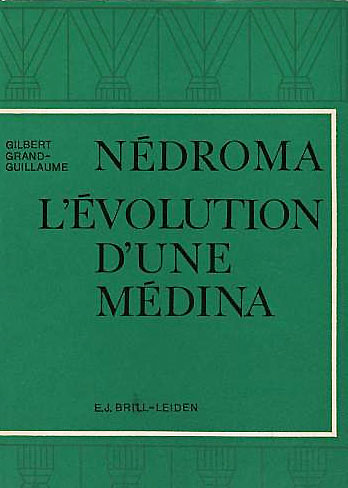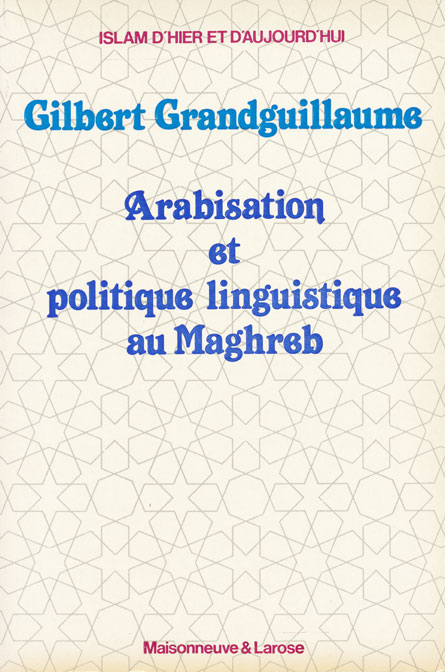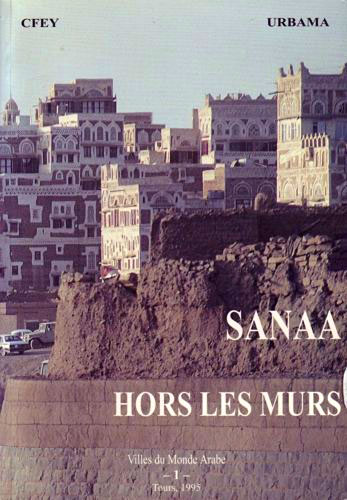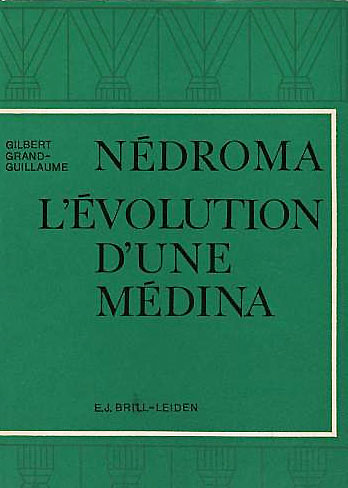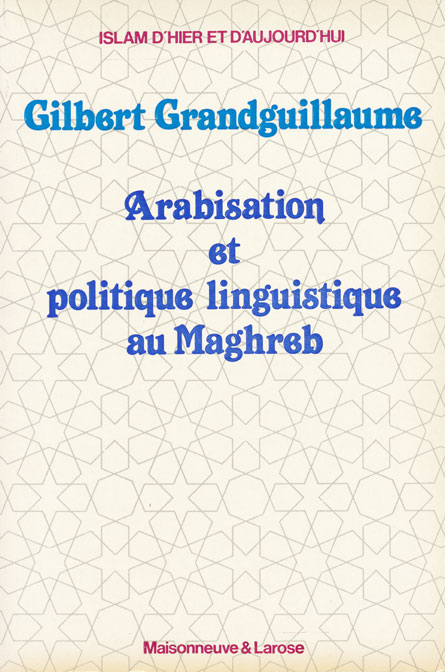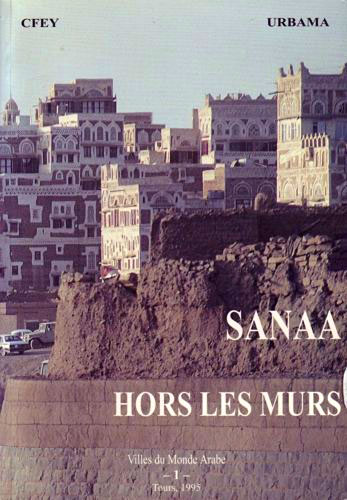|
Articles
| PAR DELA LES FRONTIERES ET LES LANGUES |
. |
Annuaire de l'Afrique du Nord Tome XXIX, 1990 Editions du CNRS
|
Sur la question des rapports entre le Maghreb, l'Europe et la France, la guerre du Golfe vient brusquement, en 1990 et 1991, de jeter une lumière crue. Jamais un tel décalage n'avait été perçu entre l'espace de l'imaginaire et le monde des réalités. Plus précisément, il faudrait parler d'un extrême décalage entre le monde de la vie quotidienne et celui des représentations. Des sociétés ont vu sur leurs écrans de télévision les mêmes images, images elles-mêmes en profonde rupture avec la réalité - une réalité de la guerre profondément ignorée ou masquée jusqu'à ce jour, mais dans le même temps, elles se sont senties plus que jamais étrangères les unes aux autres.
Durant tous ces événements en effet, le Maghreb et l'Europe, ou, si on veut en prendre le point focal, l'Algérie et la France, ont vécu à la fois dans une extrême proximité et dans une farouche distanciation. Suffirait-il de dire que, comme dans le cas de l'émigration, le rapprochement engendre la tension ? Le problème est plutôt que chacun, dans cette situation extrême, ait eu l'impression que les critères, les repères, de son identité individuelle et sociale étaient perturbés, voire manipulés à son insu, le sentiment de se trouver brusquement ramené à des formes primitives, archaïques, d'identité : quelque chose comme les Français contre les Arabes, les Chrétiens font la guerre aux Arabes. Dans de telles situations, chacun doit choisir son camp, il y est même acculé. Mais en même temps, la multiplication des prétextes, la contradiction des bons droits, l'hypocrisie des intentions était si manifeste que, face au choix si clair proposé par les politiques, l'opinion a eu le sentiment d'être trompée.
La question qui se pose maintenant est celle-ci : quels sont les critères qui font que quelqu'un est maghrébin ou européen, algérien ou français ? L'est-on dans sa tête, dans sa religion, dans ses objectifs, dans ses désirs, l'est-on en fonction de frontières, de lieux de naissance, de langues, d'ascendants, ou bien encore l'est-on parce que des hommes de pouvoir, des chefs d'Etat en ont décidé ainsi ? La question est d'autant plus complexe qu'à une fluidité saris cesse croissante des techniques, des moyens de communication, des média, des langues, s'oppose la rigidité des pouvoirs étatiques qui, afin de se constituer en pôles derniers de l'identité et donc du pouvoir, veulent renforcer les barrières, souder des blocs, étendre leur influence. Tout ceci se réalise dans l'action ignorée de mythes implicites sur lesquels s'est toujours basé le politique pour fonder sa légitimité.
Le grand problème de notre époque est que, dans les rapports FranceMaghreb, elle allie un mouvement de forte convergence dans les techniques à un mouvement d'aussi forte divergence dans les idéologies. Entre deux, le problème des langues, qui à la fois séparent et rapprochent, n'en apparaît que plus central.
DES FRONTIÈRES QUI NE FONT PLUS ÉCRAN
Chaque nation se représente sa différence avec l'autre comme définie par des frontières, qui, selon les points de vue, protègent ou enferment. Mais il faudrait bien admettre le caractère de plus en plus factice de ces limites. Si pour certains aspects de la vie économique ou administrative, elles représentent des barrières réelles, pour le reste, elles s'avèrent des limites tout à fait perméables.
Disons d'abord que, lorsqu'elles n'existaient pas - notamment durant la période de la colonisation, spécialement pour l'Algérie, les populations de France et du Maghreb ne se sont pas mélangées. Peu de mariages mixtes sur place (pratiquement pas de mariages de musulmanes à des non-musulmans), et des mouvements d'émigration dans les deux sens relativement contenus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontières que géographiques.
L'accession des trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) a marqué une nouvelle valorisation des frontières, chargées du sens nouveau de marquer les bords d'Etats indépendants, musulmans, souverains. Mais cette nouvelle situation n'a en fait que renforcé le caractère illusoire de ces frontières, comme garantissant un « chez soi ». Les échanges économiques, comme les flux de population, se sont accentués ; les emprunts culturels se sont intensifiés : que l'on songe ici à la diffusion massive de la langue française dans la population, par le biais de la généralisation de l'enseignement, alors même que les programmes affichés étaient ceux de l'arabisation, c'est-à-dire d'une mise à distance de l'influence étrangère. Si chaque Etat peut établir des visas d'entrée et de sortie, il ne peut rien contre la circulation des idées et des modes. Le stade ultime de ceci est, pour le moment, la diffusion massive de la télévision de langue française, par le biais des antennes paraboliques qui atteindraient pour le moins six millions d'Algériens, et une proportion équivalente dans les autres pays du Maghreb. Devant cette marée déferlante de mots et d'images, la récente décision algérienne (en décembre 1990) d'instaurer une arabisation totale, comportant l'interdiction d'utiliser la langue française, ne peut que paraître irréaliste, parce que condamnée à l'insuccès. Même si, par impossible, le flux des échanges humains venait à s'interrompre entre le Maghreb et la France, les fortes minorités maghrébines qui y sont fixées et s'y multiplient non seulement marquent une présence maghrébine au coeur de la France, mais y portent la garantie de liens étroits et sans doute croissants avec les populations du Maghreb. La tentative actuelle des autorités françaises d'en hâter l'intégration administrative, économique, sociale et culturelle, pour les faire en quelque sorte disparaître dans le paysage, comme ce fut le cas des immigrations italiennes, puis portugaises, apparaît tout aussi irréaliste que la volonté algérienne d'établir un cordon sanitaire linguistique.
Ces brefs rappels ne sont que destinés à mettre en lumière la réalité d'une intrication profonde des pays du Maghreb et de la France. Or c'est précisément dans ce contexte que semble se dessiner un double mouvement de repli sur ses frontières, de part et d'autre de la Méditerranée. La France semble vouloir se désengager pour s'amarrer plus étroitement à l'Europe en cours de construction. Le Maghreb s'il ne peut envisager de destinée économique autonome, voit ses sociétés massivement marginalisées par les processus dits de développement, se mettre à rêver d'un modèle qui relèverait principalement d'une origine islamique.
Comment est-il possible de penser ces situations ? S'agit-il d'une cécité volontaire face à des changements irréversibles ? Ou la prédominance est-elle encore à des mythes porteurs d'une promesse de réversibilité des choses ?
DES CHANGEMENTS INSCRITS DANS LE MYTHE DU RETOUR
Du côté français, l'Algérie a longtemps représenté comme le prolongement du territoire, de la « métropole », sans que ce territoire n'ait jamais été confondu avec le territoire national. Mais il était le support de la grandeur de la France. Si la guerre d'Algérie fut si longue et si acharnée, c'est bien parce que la « perte de l'Algérie » était identifiée avec la fin de la grandeur française, la perte d'une grandeur à la fois réelle et fantasmée que la France reproche encore aujourd'hui à l'Algérie et qui se traduit par un ressentiment d'autant plus profond qu'il n'est exprimé que sous la forme d'un « respect » du choix de l'autre. Ce ressentiment irraisonné s'est accompagné de la représentation du caractère provisoire de la présence en France de populations maghrébines. Or l'affirmation de plus en plus insistante du caractère définitif de cette présence sanctionnée par l'octroi de la nationalité française, rejoint subrepticement ce ressentiment et conduit à y voir une duperie de l'histoire.
Du côté maghrébin, et principalement algérien, les changements introduits par la situation de colonisation, dans tous les domaines, ont été acceptés ou supportés dans l'optique qu'il s'agissait de l'apport d'étrangers, provisoirement dominants. Il était donc possible éventuellement d'en profiter sans avoir à en faire le choix. Quand est intervenue la situation d'indépendance, alors qu'un choix était possible, il a été longtemps éludé par les autorités responsables sur le thème de la permanence de la domination coloniale sous des formes larvées, de néo-colonialisme, tutelle et influence : toutes choses dont il serait fort long de se débarrasser. Cette politique, qui annonçait sans cesse une autre forme de société, sans jamais la définir et encore moins la réaliser, (le cas de l'arabisation en est à la fois l'exemple et le symbole), contribuait à entretenir le même mythe qui supportait le changement et l'autorisait, à savoir son caractère provisoire : comme si l'histoire pouvait un jour revenir sur ses pas.
La présence de ce mythe apparaît au grand jour dans l'actuelle prédication islamiste, préconisant comme remède aux maux de la société le retour
sans réserve à l'âge d'or des premiers califes « bien guidés ». Mais on peut considérer que ce mythe a servi de support au vécu de l'essentiel des changements qui ont affecté la société. C'est lui qui a permis d'utiliser la langue française, au lieu de restaurer la langue arabe de façon drastique comme le fit le colonel Qadhafi en Libye, tout en excluant le principe du bilinguisme et en proclamant celui de l'arabisation : il s'agissait d'une situation provisoire, sur laquelle on reviendrait. C'est encore ce mythe qui a permis à des milliers de Maghrébins de s'installer en France avec leurs familles, d'y faire éduquer leurs enfants, sans avoir à vivre cette situation comme un reniement de leurs origines, de leurs ancêtres, de leur langue ou de leur pays (pour ne pas parler de la religion) : le fait que la situation était, en contradiction avec l'évidence, réversible, provisoire, la rendait supportable, vivable, pensable, et évitait d'en faire l'objet d'un choix.
D'AUTRES MYTHES POUR PENSER LE CHANGEMENT
Les années présentes voient l'effondrement de ce mythe du retour. La France découvre avec saisissement que les populations immigrées ne retourneront plus au Maghreb. Ces populations elles-mêmes le découvrent en même temps. Ce qui apparaît surtout, c'est l'absence de catégories mentales pour penser ces nouvelles situations, l'absence de mythes, de récits d'origine, qui en établiraient la légitimité et la rendraient acceptables.
Dans son sens dernier, le mythe du retour, c'est la négation de l'histoire, du changement. C'est le vieux rêve de l'individu et de la société, de rester « chez soi », de rester « entre soi », et de n'introduire dans la communauté de vie que le moins d'étrangers possible. C'est bien la fonction de ces langues maternelles, dialectes au Maghreb, patois en France, qui à la fois séparaient et protégeaient des communautés morcelées. Or il est bien difficile pour une société d'entrer dans les changements profonds de notre époque sur la référence d'un idéal de fixité, renvoyant à la conscience plus ou moins claire d'une supériorité de l'entre-soi.
Le problème ici n'est pas tant d'entrer dans le changement, car de toute façon celui-ci s'impose inéluctablement : les tentatives de repli sur soi, de retour en arrière (comme l'arabisation totale, ou l'idéal intégriste) exhibent, plutôt que leur étroitesse, leur irréalisme. Le problème est d'arriver à en penser la réalité, de faire de ce qui est réalité imposée ou subie une entité pensable et acceptable. mais où trouver cet instrument qui arrachera à la fascination du quotidien, pour en faire un objet de pensée, une réalité humaine ? C'est dans le langage que pourront être fondés ces mythes nouveaux qui permettront le passage à la vie.
LE PARADIGME DU LANGAGE
Comment vivre le changement sans s'y perdre ? Le langage est là pour montrer la voie. Car si une langue se modifie en permanence dans sa pra-
tique, épousant les contours du temps, elle n'en demeure pas moins ellemême, gardant en elle sa source sans avoir à y faire retour.
La langue française vit ce changement dans ses multiples niveaux d'emploi. Les patois effacés sur lesquels elle s'est implantée ont laissé les traces d'une diversité perdue ; plus anciennement, à la différence de l'italien qui a su garder l'accès à ses sources, la langue française fut par Malherbe arrachée à ses origines. Elle garde en elle l'empreinte de la violence qui lui fut faite et de celle qu'elle exerça.
Le Maghreb s'inscrit sur un registre de plusieurs langues. Il est fondé sur cette dualité qui depuis les origines, met à part une langue sacrée, soustraite à l'emploi quotidien de la langue maternelle, préservée de la sorte du changement et de l'usure. Les autres éléments en sont les dialectes oraux, variables à l'infini, qui se sont chargés de gérer le quotidien linguistique sans les amarres de l'écrit. Ils ont côtoyé, ou relayé les parlers berbères, qui témoignent d'une langue antérieure à l'Islam. Langues maternelles arabes ou berbères, elles sont, tout en restant elles-mêmes, en situation de changement continuel : celui qui s'éloigne quelques années de son terroir en trouve à son retour le parler modifié. Dans la période actuelle de changement intense, ces langues maternelles ont su emprunter, assimiler, transformer en leurs schèmes propres tous les noms dont elles avaient besoin pour nommer le changement, pour le rendre intelligible, pour s'arracher à la fascination de la nouveauté en l'apprivoisant par le nom. Mais ceux qui les parlent ont toujours le sentiment de parler la même langue, à juste titre, car cette langue reste elle-même dans son mouvement continuel. Avec la colonisation, le Maghreb a reçu des langues étrangères, notamment le français. Langue rejetée d'abord comme langue de la mécréance, elle est devenue peu à peu aussi une langue d'ouverture à la modernité, au changement. C'est par elle que le Maghreb s'est ouvert à un monde nouveau, à des valeurs différentes. Mais ce faisant, il s'est aussi approprié cette langue : elle est une langue étrangère qui fait écho à une langue maternelle du Maghreb. Cela apparaît fortement chez les écrivains de ces pays qui s'expriment en français quand les métaphores de la langue maternelle remodèlent l'expression française.
La langue arabe écrite, celle qui s'origine dans le Coran, est elle aussi entrée dans le cycle de la transformation de l'ouverture à un monde moderne. Non pas sous la forme de langue maternelle, mais plutôt par souci de reprendre à la langue française un usage qu'elle avait usurpé au Maghreb celui de l'entrée dans la modernité. Mais pourquoi cette langue n'est-elle pas efficace dans son entreprise ? Les causes techniques en sont multiples ; il serait fastidieux de les énumérer ici. Mais la raison principale, dernière, est qu'elle n'a pu prendre la forme d'aucune langue maternelle de communauté. Elle est restée la langue de l'Etat, de l'administration, de l'enseignement, de la presse, bref la langue des institutions. Si elle a pu enrichir l'arabe de nombreux termes techniques, si elle a pu ressourcer les dialectes à leurs origines arabes, elle n'a pas su se faire aimer, susciter le goût de la cultiver, d'y exprimer les profondeurs de la confrontation au monde : sur ce domaine, c'est souvent à la langue française qu'il est fait recours. Pourquoi ?
Dans cette adaptation progressive et souple au changement qui caractérise les langues parlées, la langue arabe modernisée, moderne, dite littérale, s'est trouvée représenter un pouvoir. Un pouvoir de l'Etat qui précisément ne peut se justifier qu'en rehaussant les frontières, qu'en prenant sur lui cette angoisse du changement afin de la convertir en soumission à son égard, en dévotion à son image. C'est dès lors l'ouverture qui est compromise, la langue qui est paralysée.
Si la langue est de la société, elle ne peut être de l'Etat, sous peine de devenir langue de bois, figée, apte seulement à mettre en scène ce mythe du retour à des origines pures, idéalisées ; ce qui est la tentation de tout pouvoir, de toute idéologie. Or notre époque moderne est pleine des contraintes exercées par les Etats sur les langues, pour amener les citoyens à s'identifier à l'Etat, à revenir à la maison : la démarche du « retour à la maison . , du retour à l'antérieur opposée à celle d'ouverture et de changement. Les mythes qu'elle retient sont ceux qui marquent la séparation, l'isolement, le repli sur soi : conquêtes, croisades, alors qu'elle écarte ceux qui pourraient signifier l'ouverture et l'échange, tels que la période berbère anté-islamique, l'Andalousie, voire même la colonisation, la guerre d'Algérie, alors que ces réalités de l'histoire sont présentes jusqu'à aujourd'hui dans les langues, les musiques, les arts, les monuments, et les formes diverses de la mémoire individuelle et collective.
Dans le même sillage se situent tous ces événements dont il ne faut parler : de l'histoire, même récente, du pouvoir, de la justice, de la concertation des citoyens, de l'exercice de la justice. Silence imposant qui transforme les institutions de l'Etat et de la société en autant d'entraves mises sur la voie du changement et donc de la vie.
Loin de l'exagération de l'obsession nationale, les langues auraient besoin de liberté pour que s'exprime en elles les noms des réalités nouvelles, pour qu'elles puissent dire ce qui du passé fut caché et qui travaille le présent, et que se disent en elles les nouveaux mythes qui fonderont de nouvelles identités et rendront le présent intelligible dans la lumière d'un passé toujours là.
|
|
|